L’influence - Mars 2025
En présentant la Revue nationale stratégique 2022, le président de la République a solennellement élevé l’influence au rang de sixième fonction stratégique. Les démocraties libérales, dont les vulnérabilités en matière de lutte informationnelle font l’objet de débats publics, constituent des cibles de choix pour certains régimes autoritaires ou groupes non-étatiques. Elles s’efforcent de chercher des ripostes sans pour autant renoncer aux principes et valeurs qui les fondent.
Alors que le champ informationnel est désormais identifié comme un domaine de compétition stratégique, voire d’affrontement, plusieurs publications récentes abordent différents enjeux de l’influence en matière de défense et de sécurité nationale.
Thomas Drohan conjugue l’expérience d’un officier ayant combattu sur les théâtres extérieurs, dont la Corée, et les acquis de ses activités d’enseignement de la stratégie.
« Authoritarian states use holistic, agile, and asymmetric warfare to create relative order in their societies while disrupting it abroad (Russia) or establishing a new global or regional order (China, Iran). Their vulnerability is domestic legitimacy threatened by freedom of information (p.190)
Du fait de la diffusion très large des technologies, les pays autoritaires seraient en passe d’acquérir une forme de supériorité sur les démocraties grâce à leur agilité dans l’environnement informationnel contemporain. Les distinctions traditionnelles de la stratégie entre la paix et la guerre, entre les fins, voies et moyens, entre dissuasion, contrainte, coercition et punition sont aujourd’hui bousculées. Sa définition comme l’art de gérer les fins, les voies et les moyens peut toujours servir de base à condition de conserver une souplesse conceptuelle et une flexibilité dans l’abstraction nécessaire à la mise en place (ou à la non mise en place) et au séquencement des activités pour réaliser les objectifs sans perte de signification. La compréhension de l’esprit des deux parties adverses, esprit qui est humain donc créatif, chaotique, adaptatif, est la condition de l’anticipation recherchée.
L’auteur se situe explicitement du côté de la déconstruction et du poststructuralisme, des mouvements de pensée qui savent percer à jour les intérêts de pouvoir. Comme il a pratiqué la stratégie sur le terrain, il sait à quel point les voies (le « how ») prévalent sur le but (le « why ») dans un contexte incertain et mouvant. Le défi d’une stratégie efficace ne peut être relevé que par l’étude de l’histoire qui met en évidence la trilogie holisme-agilité-asymétrie. Le holisme postule que le tout est supérieur à la somme des parties et permet de comprendre l’influence disproportionnée de certains acteurs minoritaires. L’agilité est nécessaire à l’adaptation des moyens et des voies pour maintenir les fins dans un contexte changeant, elle peut même consister en une modification de ces dernières. L’asymétrie incite l’acteur défavorisé à la maximisation de ses avantages, comme le risque d’une escalade nucléaire favorise les menées non militaires des Russes et des Chinois.
Ces trois qualités indispensables à une « stratégie des effets combinés » efficace diminuent, selon Drohan, l’importance de la violence, que Clausewitz considérait comme le seul ingrédient de la guerre. Les fins, les voies et les moyens peuvent être analysés chacun selon les prismes psychologique/physique, préventif/causal, coopératif/ de confrontation. L’influence requiert en premier lieu une réflexion de type non linéaire sur les effets et en second lieu une définition de l’information comme un écosystème de sujets, objets, conditions et processus en interaction.
L’auteur examine la politique de contrôle centralisé de la Chine qui est, selon lui, un mélange de contrainte persuasive et de coercition. A l’inverse, la Russie poursuit une politique de confrontation ouverte et engendre le chaos par la contrainte dissuasive et la coercition. Le « contrôle théocratique » de l’Iran comprend de la contrainte persuasive et de la dissuasion coercitive. Face à ces pays autoritaires qui recourent à la stratégie holiste-agile-asymétrique, le principal défaut de la stratégie américaine est politique aux yeux de l’auteur, en ce que la défense est définie par le secrétariat à la défense, alors que la sécurité relève du Conseil national de sécurité, lui-même dépendant du président et de l’approbation du Congrès. C’est au niveau des objectifs qu’une réforme doit être réalisée pour répondre au défi de la guerre de l’information qui appartient au « registre du gris ». Drohan propose onze objectifs pour répondre au manque de coopération interministérielle. Il insiste sur l’inclusion des effets désirés dans la stratégie et enjoint aux démocraties de bien comprendre les trois natures de la stratégie effective : le holisme pour subsumer le compétiteur, l’agilité pour adapter les fins, les voies et les moyens, l’asymétrie pour exploiter l’avantage. Il les invite en second lieu à utiliser le cadre des effets combinés. En troisième lieu, les démocraties doivent bien maîtriser les concepts de l’influence et en particulier comprendre que la coopération sous-entend nécessairement la confrontation.
Drohan conclut sur l’intelligence artificielle, qui constitue un défi redoutable pour des démocraties plus scrupuleuses en la matière que les pays autoritaires. Ce véritable « fossé stratégique » ne peut être comblé que si les premières portent plus attention aux effets combinés qu’aux armes combinées.
L’auteur, diplomate et ancien ambassadeur, enseigne à Sciences Po. Son article a été publié dans le dossier de la Revue Défense Nationale intitulé « Pour une stratégie d’influence ».
La France amorce donc un changement de paradigme et les mesures de mise en oeuvre seront naturellement scrutées par nos alliés comme par les adversaires. Trois dimensions en dessinent l’architecture : la légitimité des moyens, la dimension défensive, la dimension offensive.
Dans un premier temps, Pierre Buhler contextualise la création par la France de la fonction stratégique influence dans la Revue nationale stratégique du 10 novembre 2022. Héritière d’une ancienne pratique de diplomatie culturelle mise en oeuvre notamment par des Alliances françaises, la France est à nouveau le premier pays démocratique à effectuer un « saut conceptuel » à la mesure du « changement de paradigme » qu’est la guerre sur le continent européen. Face à la menace très grave que représente l’offensive des pays autoritaires sur les perceptions, par le truchement de la lutte informationnelle, et sur les normes, par l’entrisme dans les organisations internationales qui en sont chargées, les voies et moyens doivent être réorganisés de fond en comble.
Leur légitimité repose de manière cruciale sur le respect de la vérité, à l’opposé des mensonges des régimes dictatoriaux. Le volet défensif s’incarne déjà dans le service Viginum et des « dispositifs de veille au sein des ministères concernés », concède l’auteur, mais il devrait aussi se déployer selon lui dans d’autres directions comme l’interdiction de la propagande de pays peu respectueux des droits humains. Quant à l’offensive, elle consiste à mettre en avant des grands principes et textes du droit international, leur origine occidentale étant tout sauf attentatoire aux cultures des peuples opprimés.
David Colon enseigne l’histoire de la communication, des médias et de la propagande à Sciences Po où il est chercheur, ainsi qu’au CNRS. Ce livre publié en 2023 a été récompensé par le Prix de la Revue des Deux Mondes 2024, le Prix Corbay de l’Académie des sciences morales et politiques 2024 et le Prix La Plume et L’Épée 2024. Une nouvelle édition augmentée d’une postface vient de paraître dans la collection de poche Texto.
« La guerre de l’information est un conflit politique mondial dont l’enjeu final est notre esprit. Les États cherchent en effet à capter notre attention, à susciter notre engagement ou notre désengagement, à influer nos conduites en instrumentalisant les failles de notre raisonnement et de notre psychologie. Ils ont déployé des efforts scientifiques, technologiques et militaires considérables dans le cadre d’une course aux armements informationnels qui se poursuit encore aujourd’hui et qui semble ne pas connaître de limites. » (p.404)
David Colon dévoile les stratégies des commanditaires, les tactiques et parcours des acteurs : agents secrets, diplomates ou hackers, en analysant les différentes opérations qui ont émaillé cette « cyberguerre mondiale » en partie secrète.
La vérité fléchit dans le champ de bataille informationnel sous les coups de boutoir de la communication des États qui mettent les moyens de communication au service de leur influence, en recourant à la cyberguerre, à la désinformation ou à l’instrumentalisation de théories du complot. Les réseaux sociaux permettent quant à eux aux David ciblés de répondre aux Goliath, à l’instar de la propagande d’une organisation comme le Hamas, pourtant moins pourvue de moyens physiques qu’Israël, ou encore de « l’étrange défaite de Mossoul » qui s’explique par la terreur qu’ont instillée les vidéos de Daech diffusées sans compter.
D’après l’auteur, la militarisation de l’information a franchi un seuil lors de la guerre du Golfe au cours de laquelle les États-Unis se sont livrés à un rigoureux contrôle des médias, à une dissimulation des vérités dérangeantes et une diffusion de mensonges. La doctrine américaine de « domination informationnelle » (information dominance) date de 1996 et sa mise en oeuvre repose à la fois sur la collecte massive de données facilitée par la maîtrise des infrastructures de l’internet et de l’espace, le réseau Echelon, l’expérience de la diplomatie publique qui reprend du service après le 11 septembre et le développement des opérations psychologiques dans le domaine militaire. Dès après le 11 septembre, George Bush Jr crée l’Office of strategic influence tandis que des opérations de « communication stratégique » commanditées par la CIA trompent les médias occidentaux, qui succombent également avec facilité aux sirènes des services russes ou britanniques dont l’intoxication est une spécialité ancienne. Les Américains relancent la machine de l’information de la Guerre froide sous la forme du Global engagement center et créent en 2009 le CYBERCOM, deux organismes dirigés par la même personne.
Le pouvoir russe consacre quant à lui un énorme budget à ses canaux internationaux et à ses fabriques d’information travaillant sous contrat avec l’État, par exemple l’Internet research agency de feu Prigojine, pour atteindre des objectifs stratégiques, telle la prise de l’Ukraine, ou encourager les facteurs de déstabilisation en Occident, tels le Brexit ou l’élection de Donald Trump. Aux yeux de l’auteur, ce sont les Russes qui lient défense informationnelle et cybersécurité, soit le contenu et le contenant. La désinformation est une pratique ancienne datant de la tsarine Catherine et reprise par les Bolcheviks qui l’érigèrent en « arme de déstabilisation massive », richement dotée et à prétention scientifique. Les « mesures actives » ne cessèrent pas avec la fin de la Guerre froide, nourrissant le complotisme, les mouvements antivax, le conservatisme de l’alt-right et les intrusions dans les processus électoraux, mettant à profit la viralité des réseaux sociaux, surtout s’agissant des fausses informations. L’auteur explique pourquoi la cyberguerre et la désinformation russes ont joué un rôle finalement moins important que prévu en Ukraine, ayant été débordées par les contre-mesures américaines et par un récit ukrainien efficace à l’endroit des Occidentaux. La contre-offensive informationnelle russe n’en fut pas moins acharnée, y compris en France. Avec sa précision d’historien, il démêle également les fils de la collusion qui s’est nouée entre l’extrême droite américaine et les services russes pour exploiter à des fins de recrutement l’abondant gisement des « like » sur les réseaux sociaux. L’auteur revient plus particulièrement sur la secte sans gourou QNON, dont la traduction dans la réalité de la plus connue de ses élucubrations est l’attaque du Capitole le 6 janvier 2021.
Malgré l’importance de leur réseau audiovisuel extérieur, la qualité de leur ciblage des Russes dans l’Hexagone et en Afrique, ainsi que la prise de conscience relativement précoce de la gravité de la menace informationnelle sur le champ de bataille, les Français tardèrent, selon l’auteur, à développer leur doctrine de « lutte informatique défensive et offensive » et leurs capacités en matière de cyberdéfense COMCYBER. Si les processus électoraux bénéficient désormais des services de l’agence Viginum (Vigilance et protection contre les ingérences numériques étrangères), il reste à prendre au jour le jour toute la mesure de la malveillance d’États autoritaires que gêne la France avec son histoire et son héritage universaliste.
Un chapitre entier est consacré à la cyberguerre américano-chinoise, à la fermeture numérique de la Chine, à sa « diplomatie du loup guerrier » et à la duplicité de TikTok, qui dépend du gouvernement chinois et relaie sa propagande pro-russe. Selon l’auteur, la gravité de la situation impose un « état d’urgence informationnel » dans les démocraties, avec en France la nécessité d’adopter une approche globale incluant tous les acteurs étatiques de l’information et une plus grande coopération des entreprises de la Tech.
L’auteur est slavisant et politiste. Il livre ici une édition revue et augmentée de Russia Today, un précédent ouvrage issu de sa thèse et paru en 2021.
« Ce livre est enfin divisé en quatre parties. La première est consacrée à l’édification du réseau, à son fonctionnement institutionnel et au mode de diffusion de ses contenus. La deuxième partie présente les différents « visages » de RT dans leur diversité, dirigeants, chefs de rédaction, journalistes et animateurs, et interroge la manière dont ils contribuent à la fabrique de l’influence russe. Enfin les troisième et quatrième parties déconstruisent le positionnement « alternatif » développé par RT depuis une quinzaine d’années, autant comme mode de communication et de légitimation que comme fil conducteur de sa ligne éditoriale flexible et composite. » (p.43)
Maxime Audinet a effectué « quatre enquêtes de terrain ethnographique » à Moscou et en France, c’est-à-dire qu’il s’est rendu sur les lieux de « production de l’influence russe » et a mené une soixantaine d’entretiens, notamment avec des acteurs de cette influence russe. Il a surtout pris connaissance de tout ce que RT a diffusé ou que ses dirigeants ont publiquement déclaré. En complément, il a effectué un « terrain numérique », soit la collecte et le traitement des traces laissées par RT dans l’espace informationnel général. Il a mis à profit les outils de l’analyse textuelle et de la lexicométrie de corpus volumineux.
L’auteur explicite la notion d’influence qui recouvre selon lui en partie celle de pouvoir : la coercition en est absente mais la manipulation y est présente. Conscient de la difficulté à appréhender le sujet des médias russes internationaux, il distingue trois courants chez les chercheurs. Un premier courant met l’accent sur les enjeux sécuritaires, les intentions hostiles, le sharp power, imputé à tort à une prétendue doctrine Guerassimov, alors que cette guerre hybride était pratique courante pendant la Guerre froide. Un deuxième courant, celui des public diplomacy studies, propose une grille conceptuelle très adaptée selon Maxime Audinet à l’étude des médias internationaux et capable d’envisager une certaine attractivité des valeurs promues par la Russie. Enfin un dernier courant de pensée utilise la notion de propagande avec le plus d’objectivité possible, c’est-à-dire en la comprenant comme intrinsèquement opaque et manipulatoire à l’intention de sa cible. L’auteur reprend l’expression d’« influence informationnelle » (informatsionnoïe vozdeïstvie) employée par les doctrines russes, dont il n’exclut pas complètement une composante de soft power et qu’il juge pouvoir rattacher au concept d’« autocratie informationnelle », c’est-à-dire à l’idée d’un ciblage intérieur. Il juge pertinente à l’extérieur la distinction entre média d’État et média de service public : dans le premier, tout conflit est évacué du discours diffusé et la politisation est portée par l’État. Maxime Audinet invite à distinguer, « dans un écosystème d’influence informationnelle russe composite et, la plupart du temps non coordonné », les acteurs étatiques, les acteurs non officiels et les acteurs tiers. Les premiers comprennent le réseau RT, le média en ligne multilingue Russia Beyond, l’agence d’information internationale Rossia Segodnia - dont Sputnik est la branche proprement internationale, la « diplomatie numérique » et les unités chargées des opérations informationnelles au sein du ministère de la Défense. Les acteurs non officiels sont les « entrepreneurs d’influence, tel feu Evgueni Prigojine à l’origine du « projet Lakhta », et autres « contractuels de l’influence » ou « technologues politiques ». Les acteurs tiers sont quant à eux des natifs non russes des pays ciblés.
Le capitaine de frégate Jérémy Bachelier, après une carrière principalement tournée vers les opérations extérieures, appartient au Laboratoire de recherche sur la défense (LRD) du Centre des études de sécurité de l’IFRI. Héloïse Fayet détient un double master en journalisme et sécurité internationale. Elle a été analyste au sein du ministère des Armées et apporte au Centre des études de sécurité de l’IFRI ses compétences sur la dissuasion et la géopolitique du Moyen-Orient. Le commandant Alexandre Jonnekin est officier de l’armée de l’Air et de l’Espace, spécialiste de la maîtrise des armements, de la réflexion et du rayonnement stratégique au sein du LRD. Le lieutenant-colonel François Renaud, issu de l’armée de Terre et inséré lui aussi dans le LRD, est spécialiste des enjeux sécuritaires et stratégiques français, des nouvelles stratégies et de l’évolution des formes d’engagement des outils de défense.
« Ainsi le signalement peut s’inscrire dans la stratégie militaire d’influence (SMI), aux côtés des autres branches que sont les actions civilo-militaires, les Key leaders engagements, les opérations psychologiques et les affaires publiques militaires. » (p.42)
Les auteurs constatent que l’expression « signalement stratégique » est de plus en plus employée dans les documents officiels français concernant les armes conventionnelles alors que, dans un passé récent, elle était réservée au nucléaire. Des signaux conventionnels sont émis sur le terrain mais sans avoir été planifiés (sauf l’exercice ORION), ce qui « peut limiter l’efficacité de la démarche, que ce soit en termes de portée, de crédibilité ou de cohérence. » Ils s’appuient sur deux théories scientifiques, celle des communications et celle des jeux. La première, qui souligne l’importance de maîtriser les perceptions, est ici appliquée aux actions militaires plutôt qu’aux messages verbaux. La seconde permet de modéliser des situations complexes lourdes d’incertitude dans les relations internationales et la guerre.
Dans le domaine de la dissuasion nucléaire, la réflexion sur les signaux stratégiques est maintenant ancienne et très élaborée mais les dispositifs de concertation sont mis à mal par certains des détenteurs historiques de la bombe et par la montée en puissance de nouveaux États nucléaires. La France dispose de deux composantes pour sa dissuasion : les Forces aériennes stratégiques se font volontairement observer et pourraient effectuer la frappe d’ultime avertissement, dernier stade du signalement stratégique nucléaire et spécificité de la doctrine française. Les activités des SNLE sont beaucoup plus discrètes mais pas complètement secrètes. Ce savant dosage de clarté et d’ambiguïté résulte du caractère très resserré de la chaîne de commandement où le seul décideur est le président de la République. Le signalement stratégique conventionnel doit lui aussi être politique mais présenter suffisamment de risques et de capacités pour se distinguer des multiples activités de routine, absentes du domaine nucléaire. L’unité d’action naît d’une unité entre le sens signifiant ou le pourquoi, et le sens significatif porté par la nature même de l’action (opération Thunder Lynx du 22 juin 2022). Les objectifs politiques appartiennent à trois grandes catégories, rappellent les auteurs : affirmer un statut (exercice Pégase), dissuader ou décourager un adversaire (Enhanced forward presence) et contraindre ou faire pression (par exemple escorter deux bombardiers russes qui survolaient la Manche en 2015). Le message doit être différentiel et crédible, par la quantité, la qualité, la géographie, la coopération.
Les auteurs, après avoir ainsi posé les conditions de réussite d’un signalement stratégique conventionnel, s’attaquent à la difficile question de son articulation avec la nouvelle fonction stratégique d’influence. Ils rappellent que la doctrine otanienne enjoint aux États membres de communiquer dans tous les domaines régaliens, non forcément strictement militaires, ce qui s’accorde avec l’élaboration en cours au niveau interministériel de la stratégie nationale d’influence. La Stratégie militaire d’influence, déjà pourvue d’une doctrine, peut servir de cadre au signalement stratégique.
Les auteurs esquissent enfin une possible distribution des rôles, consistant à laisser au Conseil de défense et de sécurité nationale et au Conseil restreint la responsabilité de « clarifier l’intention politico-stratégique ». La matrice DIMEFIL (Diplomatie, Information, Militaire, Economique, Financier, intelligence, légal) de l’OTAN peut ensuite être déclinée. Il reviendrait en troisième lieu au ministère des Armées d’utiliser le bureau J-IM (Influence militaire) de l’EMA (Etat-major des armées) pour discerner les activités du CPCO (Centre de planification et de conduite des opérations) susceptibles de relever d’un signalement stratégique. La cohérence interministérielle étant de mise également lors de la conduite et de l’émission du signal stratégique, le SGDSN pourrait être à la manoeuvre, à condition de devenir l’équivalent d’un Conseil de sécurité nationale. Sur le terrain, les ambassadeurs et les attachés de défense s’assureraient de la qualité du ciblage puis du décodage et de l’interprétation par les récepteurs. Les ambassadeurs dits régionaux ou thématiques pourraient voir leurs missions précisées dans le sens d’une plus grande coordination avec les commandants interarmées. L’évaluation de l’impact reviendrait aux services de renseignement, notamment au plateau Ciblage de la DRM et au Centre interarmées d’actions sur l’environnement. L’effet sur les alliés serait à évaluer par les attachés militaires. Il serait aussi utile de recourir au « ciblage large spectre » et aux outils techniques les plus innovants comme les cartographies d’audience ou les modélisations du comportement de l’adversaire dans les jeux de guerre. Les méthodes de prospective, notamment la démarche contrefactuelle permettraient enfin d’envisager les potentiels signaux stratégiques de l’autre camp.
Simon Magnon, enseignant et chercheur à Aix-en-Provence, a publié cet article dans ce dossier consacré à « La Diplomatie publique à l’heure des réseaux ».
« A rebours des lectures globalisantes qui consacrent l’idée d’une guerre informationnelle ou d’une diplomatie de l’influence analysée par le haut, il s’agissait ici d’observer la fabrique d’une diplomatie publique à partir d’un espace localisé, de ses acteurs intermédiaires et de ses réseaux. »
Simon Maignon se propose d’analyser l’aide française aux médias étrangers comme une forme de diplomatie publique. Il montre notamment le rôle structurant de l’État dans l’encadrement de cette action extérieure.
Canal France international (CFI), à sa naissance en 1989, dépendait étroitement du ministère de la Coopération et devait contribuer au maintien de l’influence française à l’étranger, tout en s’insérant sur le marché des médias puisqu’il procurait des émissions à des prix défiant toute concurrence. En 1999, le ministère de la Coopération disparaît et le CFI se transforme en agence pilotée par le ministère des Affaires étrangères, contrainte de respecter un contrat d’objectifs.
L’auteur se livre ensuite à une recherche de terrain pour souligner la fragmentation de cette diplomatie publique. De nombreux acteurs assez divers de l’aide aux médias étrangers (ONG ou écoles de journalisme) existaient, offrant des formations au métier de journaliste selon les demandes et dans un esprit d’accompagnement de longue durée, alors même que CFI est bénéficiaire d’une subvention de l’État et répond à une logique de bailleur de fonds ou à une logique de projets. Le modèle professionnel transmis par CFI, devenu entre-temps un monopole en matière d’aide aux médias, est celui du « journalisme sans frontières », censément apolitique mais en réalité intermédiaire de l’action publique conformément à une conception anglo-saxonne et nourrie d’optimisme quant aux techniques.
L’auteur dresse une typologie des acteurs qui mettent en oeuvre l’aide aux médias étrangers, qui fait apparaître cinq profils très différents mais où dominent de plus en plus les diplomates et des experts techniques préoccupés par l’atteinte des objectifs de développement durable au détriment des journaliste, reflet des luttes et concurrences entre acteurs pour la définition de ce modèle.
https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/32688
Paul Charon allie des compétences de politiste, sinologue et juriste à une expérience dans le renseignement puis au ministère des Armées. Il a rejoint l’IRSEM, alors dirigé par Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, chercheur et diplomate auteur de plusieurs ouvrages sur les relations internationales dans un contexte de conflictualité hybride.
Machiavel disait qu’« il est plus sûr d’être craint que d’être aimé ». Mais il ajoutait aussitôt, en lecteur de Cicéron, que « le prince qui veut se faire craindre doit s’y prendre de telle manière que, s’il ne gagne point l’affection, il ne s’attire pas non plus la haine ; ce qui, du reste, n’est point impossible ; car on peut fort bien tout à la fois être craint et n’être pas haï ». C’est précisément ce à quoi Pékin n’est pas parvenu. (p.700)
Les auteurs de ce rapport diffusé pour la première version en 2021 sur internet, ne se réclament que de leur propre initiative concernant un sujet qu’ils ont déjà fait leur, élargissant leur intérêt de la lutte informationnelle à l’influence.
Dénonçant l’activisme d’un régime politique marxiste autoritaire, ils commencent par définir « les mots de l’influence chinoise » : le Front uni, les Trois guerres (psychologique, de l’opinion publique et du droit), les Opérations dans le domaine cognitif, le Pouvoir discursif, la Guerre politique, les Mesures actives (venues tout droit du KGB), en insistant sur les deux premières notions jugées encore trop méconnues.
Une seconde partie est consacrée aux acteurs de la guerre d’influence, un sujet complexe selon les auteurs. En effet, contrairement à une unité imaginée par les Occidentaux, plusieurs entités interviennent : le Parti communiste, l’État, l’Armée et le Marché et chacune d’entre elles est disséquée du point de vue de ses responsabilités dans le domaine de la guerre politique. Par exemple, au sein du PCC, le Département de la propagande, le Département du travail de Front uni, le Département des liaisons internationales et la Ligue de la jeunesse ont des compétences propres en matière d’influence que les auteurs scrutent jusqu’au moindre bureau, parfois occulte comme le bureau 610 qui lutte contre le mouvement Falun Gung en RPC et à l’étranger. Au sein de l’État opèrent le ministère de la sécurité d’État (dont l’organigramme est ici détaillé) et le bureau des Affaires taïwanaises. L’Armée populaire de libération, au service du Parti et non de la Nation, a été réformée en 2015 et la documentation ne manque pas sur ce sujet, selon les auteurs, sauf pour la composante dite Base 311, dépendant de la Force de soutien stratégique, et que seules des méthodes de renseignement en sources ouvertes utilisées par les auteurs permettent d’appréhender et de reconstituer en trente pages. Ils se livrent en complément à une étude prosopographique de la « tentaculaire nébuleuse de plateformes relais ». Enfin, les entreprises publiques et privées servent à la collecte de données indispensables aux actions d’influence.
Le plus long chapitre est consacré aux actions elles-mêmes, avec une catégorisation des opérations visant à séduire et subjuguer ou à infiltrer et contraindre, les premières étant les plus efficaces et redoutables selon les auteurs qui se livrent à une critique en règle des quatre récits destinés à différents publics. Le « modèle chinois », selon la production du PCC en langue chinoise, vise l’avènement d’un ordre mondial façonné et dirigé par celui-ci. Au nom de « la tradition », la médecine chinoise est reconnue à l’OMS même si son efficacité n’est pas prouvée. La « bienveillance » est à l’origine un concept confucéen mis en avant actuellement par le PCC avec une sincérité non dénuée de calculs. La Chine apporte, de plus, un grand soin à la diffusion d’une image de « puissance ». Les diasporas, au sens le plus large et ethnique du terme, sont considérées comme une menace à contrôler étroitement et une opportunité à mobiliser. La gestion des médias illustre le mieux, selon les auteurs, l’asymétrie fondamentale entre les dictatures et les démocraties même si la propagande manque de subtilité pour convaincre ses supposés récepteurs. L’infiltration dans les organisations internationales ou européennes privilégie les postes normatifs ou à responsabilité, notamment dans les domaines des droits humains et de la santé. Les auteurs donnent raison à ceux qui qualifient la « diplomatie des loups guerriers » de « diplomatie de voyous ». En effet, le ton des propos devient de plus en plus agressif, notamment sur les réseaux sociaux et depuis la crise du COVID. Cette « russianisation », pourtant contre-productive aux yeux de beaucoup, est appelée à durer selon les auteurs. Selon eux, les entreprises occidentales, les partis ou événements politiques, les universités risquent de se rendre dépendants de financements chinois et de subir des pressions politiques. Les menaces à la liberté académique s’accompagnent d’espionnage et le programme Mille talents peut se révéler trompeur. Les Instituts Confucius ne sont pas de simples équivalents chinois de l’Alliance française. Pour défendre ses thèses, la Chine a ses propres think tanks tout en investissant ceux de pays occidentaux qu’elle soumet ou rallie à sa censure. De même, les auteurs occidentaux de produits culturels, fascinés par le marché chinois, doivent s’y conformer.
Cinq pays sont étudiés de manière approfondie : Taïwan, Hong Kong en 2019, Singapour, finalement peu réceptifs, la Suède comme une antithèse à mater par un ambassadeur incompétent mais véritable « loup gris » (passage qui explicite le sous-titre de l’ouvrage) et le Canada qui abrite depuis longtemps une importante diaspora chinoise et a alerté les Occidentaux sur les menées de la RPC dès 1997. La France n’est pas étudiée en tant que telle mais identifiée comme une future cible des opérations d’influence chinoises. La Nouvelle-Calédonie indépendante pourrait tomber « directement » dans l’escarcelle chinoise, comme Okinawa où vivent des populations qui ne se veulent pas japonaises.
Le dernier chapitre est un ajout à l’édition précédente et concerne la guerre russo-ukrainienne durant laquelle Moscou et Pékin oeuvrent de concert, de manière volontairement et habilement lacunaire, se sachant relayés par les imaginaires puissants et préparés de longue date.
Les auteurs, pour la plupart, d’anciens serviteurs de l’État américain, sont membres du Center for international and strategic studies, une organisation de recherche bipartisane à but non lucratif.
« This report examines Chinese political warfare, which includes actions below the threshold of conventional warfare designed to achieve a state’s national objectives. »
Les auteurs sont préoccupés par ce qu’ils considèrent comme une lacune de la défense américaine face à une Chine qui agit avec une ampleur inédite pour protéger le pouvoir du Parti communiste, affaiblir les États-Unis et leurs alliés et étendre sa puissance et son influence. Les auteurs mettent en lumière ce qu’ils appellent la « logique stratégique » de la guerre politique chinoise, c’est-à-dire ses aspects stratégiques, conceptuels et organisationnels. Leur analyse des opérations de renseignement, qui font partie intégrante de la guerre politique, part des entités qui en sont chargées avant de présenter leur manière d’opérer et notamment de recruter des sources humaines d’information d’intérêt militaire ou technologique, souvent dans la diaspora (programme dit Fox Hunt). Si la traçabilité de ces méthodes est moindre que celle des opérations cyber, pensent les Chinois, la cyberguerre représente pourtant à leurs yeux une partie de la guerre informationnelle et l’année 2015 a vu son renforcement capacitaire, au point de dépasser la Russie en nombre d’opérations. Le chapitre sur l’information et la désinformation traduit l’inquiétude des auteurs sur le pouvoir de censure hors des frontières de la RPC et même à l’intérieur de celles des États-Unis, dont les dispositifs existants de lutte contre les influences étrangères sur les législateurs ne seraient pas assez efficaces. Le Front Uni est en train de redevenir la pierre angulaire (« corner stone ») du Parti communiste, au point de jouer le rôle d’un service de renseignement selon certains universitaires que les auteurs approuvent.
Les actions militaires irrégulières sont parties intégrante de la guerre politique et ont lieu dans les mers de Chine du sud et de l’est, élevant de facto le dragueur de sable au rang d’arme d’offensive et les voies de fait telles que les exercices militaires ou les harcèlements divers à celui d’instruments de revendications territoriales et enfin la flotte de pêche à celui de milice. Au loin, la Chine déploie ses compagnies privées de sécurité, ses efforts de recherche aux arrière-pensées stratégiques et l’Initiative de sécurité mondiale est présentée officiellement comme un maillon entre sa sécurité intérieure et sa politique étrangère. Il ne s’agit en rien du type de coopération entre entités séparées pratiquée dans les pays démocratiques, jugent les auteurs. La Route de la soie, digitale ou non, et les sanctions économiques émanant de la Chine appartiennent au registre de la coercition économique, considérée par les auteurs comme un moyen de la guerre politique.
Pour contrer toutes ces menées, il revient avant tout aux pays démocratiques de se présenter en alternative à l’autoritarisme, de mieux connaître leur adversaire, de concevoir et mettre en oeuvre des moyens de défense et d’attaque appropriés.
[N.B. : toutes les références dépouillées dans ce bulletin sont disponibles à la bibliothèque de l’École militaire ou, pour certaines, accessibles en ligne pour les lecteurs éligibles.]
Contenus associés
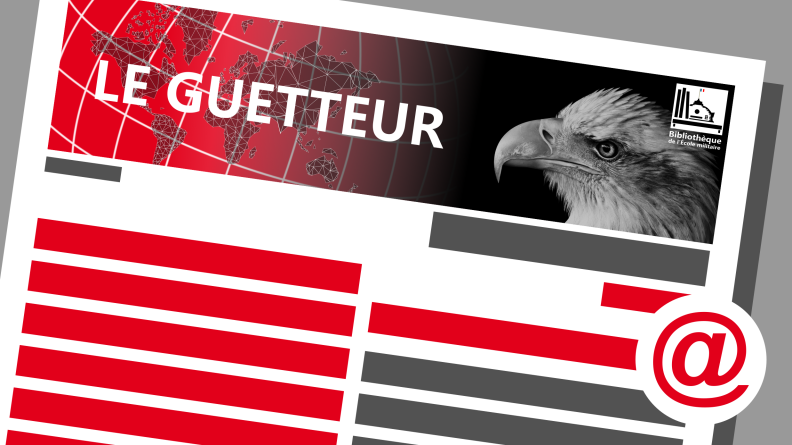
Nouveaux rapports de force en Afrique : entre essor sino-russe et repli français.
1er juillet 2025
17 juillet 2025
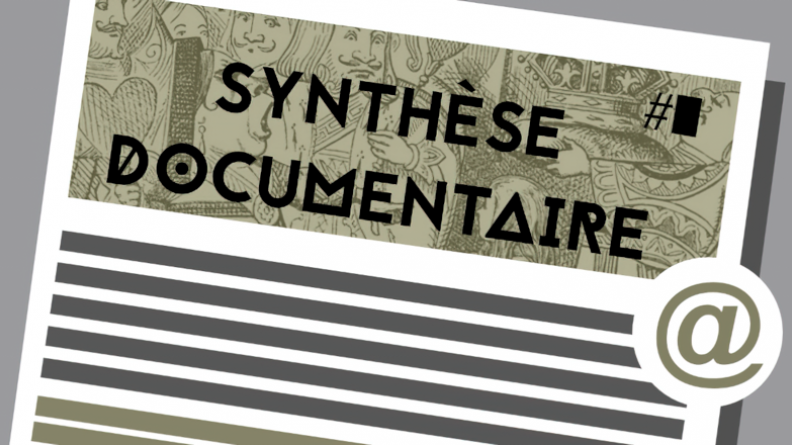
Visite d’Emmanuel Macron en Égypte : vers un retour de la « politique arabe » de la France ?
Date : 16 juin 2025
17 juillet 2025
