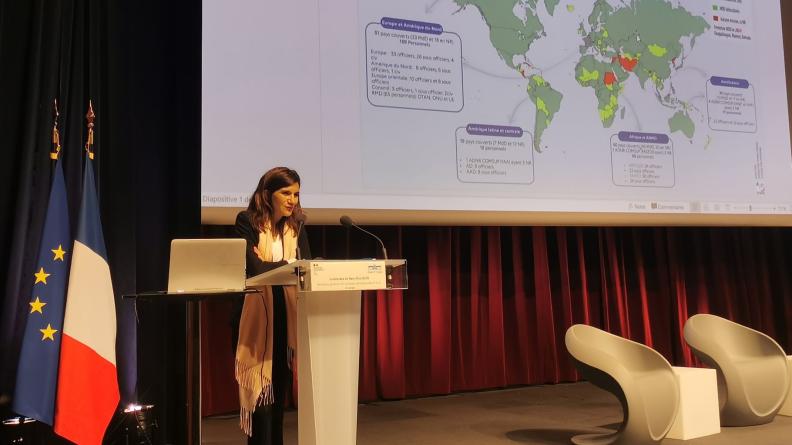La France et le G5 Sahel
Le G5 Sahel fut l’objet de l’attention internationale lors du sommet du G7 à Biarritz en août 2019.
De nombreuses questions demeurent depuis en débat, avivées par la mort de 13 militaires français en pleine opération contre les djihadistes au Mali le 25 novembre. Le président Macron avait souhaité la réunion exceptionnelle du G5 Sahel à Pau le 16 décembre, initiative finalement reportée au 13 janvier 2020 suite à la mort, le 10 décembre 2019, de 71 militaires nigériens dans la zone dite des « trois frontières ». Ce sommet de Pau visait à clarifier le rôle de chacun des intervenants dans la région, afin de fixer une feuille de route politique et sécuritaire renouvelée.
En guise d’introduction : Diplomatie. Les Grands dossiers, n°48, décembre 2018 présente une carte utile à l’appréhension des enjeux de sécurité au Sahel (p.73).
À travers les interventions Serval puis Barkhane,
la France est-elle en phase avec les problèmes du Sahel, en respectant la souveraineté des pays concernés?
CHATAIGNER, Jean-Marc. « Sahel et France, enjeux d’une relation particulière », Hérodote, n°172, 1/2019 (p.123-136)
L’auteur, ambassadeur et envoyé spécial pour le Sahel, explique que le djihadisme au Mali s’est greffé sur des problèmes anciens que la France connaît bien en tant qu’ancienne colonisatrice, comme la mainmise difficile par le pouvoir de Bamako sur des espaces désertiques peuplés de Touaregs nomades. Les djihadistes ont gagné les allégeances d’ethnies davantage animées par des sentiments d’injustice que religieux, allégeances dès lors réversibles. Le colonialisme et la « Françafrique » sont révolus : la France n’est pas seule, elle agit conjointement avec la communauté internationale (Algérie, ONU, UE) et les pays sahéliens. Elle a plaidé avec succès pour le développement, qui est le véritable enjeu, et a intégré les pays européens dans l’Alliance Sahel en 2017. Elle a appuyé la création du G5 Sahel dans l’intention de quitter la zone à terme.
PEROUSE DE MONTCLOS, Marc-Antoine. « La politique de la France au Sahel : une vision militaire », Hérodote, n°172, 1/2019, (p.137-152)
Marc-Antoine Pérouse de Montclos est politiste et travaille au sein de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) de l’Université Paris-Descartes. Il est moins optimiste : selon lui, l’action de la France est contre-productive et la situation est pire qu’à son arrivée : les djihadistes sont dispersés et plus violents. Elle a, certes, bien compris que la menace était transnationale, mais le G5 Sahel regroupe le Mali, le Niger, le Tchad, la Mauritanie et le Burkina Faso, écartant le Sénégal tandis que l’Algérie refuse d’en faire partie. L’aide au développement préconisée par la France ne peut pas servir à la contre-insurrection. La priorité est plutôt de renforcer les Etats et d’améliorer la gouvernance. L’intervention de la France est, de ce fait, mal ressentie par les populations qui l’accusent volontiers de néocolonialisme.
Le G5 Sahel et sa Force conjointe sont-ils légitimes et efficaces ?
DESGRAIS, Nicolas. « La Force conjointe du G5 Sahel ou l’émergence d’une architecture de défense collective propre au Sahel », Les Champs de Mars, n°30, 1/2018, (p. 211-220)
Nicolas Desgrais joint l’expérience à la recherche académique. Doctorant à l’Université de Kent, anciennement en poste au ministère de la Défense, il rappelle que l’Union africaine et son Architecture de paix et de sécurité (APSA) n’ont pas vu venir le danger. Le Sahel n’appartient qu’en partie à la CEDEAO (l’une des huit communautés économiques régionales), obligeant à des créations innovantes comme l’Initiative des pays du Champ voulue par l’Algérie d’une part, inefficace, et la Force conjointe du G5 Sahel qui s’en inspire d’autre part et a été acceptée par l’UA. Les pays du Sahel se sont donc approprié leur sécurité. La Force conjointe patrouille près des frontières où les armées ne vont pas. Pour mieux accomplir ses missions, il lui faut mobiliser des hommes et des financements refusés par l’ONU à cause du veto des Etats-Unis.
BENANTAR, Abdennour. Les initiatives de sécurité au Maghreb et au Sahel. Le G5 Sahel mis à l’épreuve, Paris, L’Harmattan, 2019, (282 p.)
Maître de conférences en science politique à l’Université de Batna en Algérie puis à l’Université Paris 8, l’auteur est également chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS). Selon lui, le G5 Sahel, né en 2014, n’est que la dernière des nombreuses initiatives de sécurité qui prolifèrent au Maghreb et au Sahel. Il existe ainsi des chevauchements et des contradictions. Le G5 Sahel est soutenu par la France et l’Europe mais se heurte aux méfiances américaine et africaine. Pour pallier ces défauts et apaiser les inquiétudes, il s’agit de coordonner l’ensemble, et de se concentrer sur les données politiques et économiques. Il faut comprendre que le format G5 Sahel est le seul à pouvoir obtenir des financements internationaux ; c’est ce qui lui permettra de survivre.
AUBRY, Ayrton. Le G5 Sahel. Le nouveau régionalisme sécuritaire en Afrique du Nord-Ouest, Paris, L’Harmattan, 2019, (182 p.)
Ayrton Aubry est politiste et doctorant au Centre de recherches internationales (CERI) de Sciences Po. Critique vis-à-vis du G5 Sahel, il pense qu’il est composite, révélateur de l’existence d’un complexe régional de sécurité en Afrique du Nord-Ouest, mais composé d’Etats faibles aux régimes autoritaires. Selon lui, il est le lieu d’un processus d’extraversion et de « sécuritisation » : autrement dit, de l’appropriation par les régimes de fonds internationaux, obtenus en invoquant les problèmes de sécurité ; ce qui attise les rivalités entre pays occidentaux (France et Etats-Unis). L’APSA, elle, est plus sensible au sort des populations vulnérables.
« G5 Sahel joint force and the Sahel Alliance », Military technology, The world defence almanac, 2018, (p.214-215)
L’article de cette revue américaine souligne que la Force conjointe du G5 Sahel, lancée en 2017, a pour mandat la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue, la restauration de l’autorité de l’Etat et le retour des réfugiés, la facilitation de l’aide humanitaire, la contribution au développement. Il considère que le programme est bien avancé et bien articulé avec la MINUSMA. Il relève que la Force conjointe a un quartier général et a réalisé l’opération Pagnali sans Barkhane, comblant les lacunes de cette dernière et de la MINUSMA. L’Alliance Sahel est la deuxième composante de l’Alternative pour le Sahel ; lancée par la France et l’Allemagne, elle coordonne le développement.
Quel est le bilan du G5 Sahel et comment doit-il se réformer ?
DESGRAIS, Nicolas. Cinq ans après, une radioscopie du G5 Sahel, Fondation pour la recherche stratégique, 12 mars 2019
https://www.frstrategie.org/programmes/observatoire-du-monde-arabo-musulman-et-du-sahel/cinq-ans-apres-une-radioscopie-g5-sahel-2019 (consulté le 6/01/2020)
Le seul organe permanent du G5 Sahel est le Secrétariat permanent qui est tiraillé entre son rôle technique et celui de coordination entre les différents projets. Ses moyens devraient être renforcés pour mieux assurer les interactions des deux piliers du G5 Sahel, la sécurité et le développement. La « Stratégie pour le développement et la sécurité » doit être actualisée afin de prendre en compte deux évolutions : le financement du Programme d’investissements prioritaires et le contrôle des zones transfrontalières par la Force conjointe.
CHATELOT, Christophe. Contre-terrorisme : les limites du G5 Sahel, Le Monde, 3 septembre 2019
La menace glisse actuellement vers le golfe de Guinée. Lors du sommet du G7 à Biarritz, fin août 2019, a été annoncée la création d’un « Partenariat pour la sécurité et la stabilité pour le Sahel » qui regroupera le G5 Sahel, les pays côtiers (Togo, Bénin, Ghana, Côte d’Ivoire), le Sénégal et les bailleurs internationaux. Le G5 Sahel risque d’être court-circuité par la CEDEAO, préférée par Bruxelles. Il manque de financements car les Etats-Unis ne veulent pas qu’on le place sous le chapitre VII du Conseil de sécurité de l’ONU.
« La menace terroriste grandit au Sahel », entretien avec Mahamadou ISSOUFOU, Le Figaro, 16 septembre 2019
Le président du Niger est satisfait du sommet de Ouagadougou lors duquel il a été annoncé que la CEDEAO allait débloquer un budget de 1 milliard de dollars sur cinq ans à comparer aux 100 millions du budget actuel du G5 Sahel. Selon lui, il y aura subsidiarité entre la CEDEAO et le G5 Sahel : ils se partageront les tâches mais cela ne suffira pas. Une coalition internationale est nécessaire, comme contre Daech en Syrie, puisque ce sont les Occidentaux qui ont déstabilisé la Libye d’où sont partis les maux actuels du Sahel.
Quelles perspectives à court terme pour les Français et la Force conjointe ?
GOYA, Michel. La force de nos ennemis, c’est la faiblesse de l’Etat malien, Le Monde, 2 décembre 2019
Michel Goya, ancien colonel des troupes de Marine, livre un point de vue stratégique. Il repère la succession de deux types d’opérations françaises au Sahel selon leurs objectifs. L’opération Serval a été séquentielle et suivie de succès visibles. Les Français auraient dû alors se retirer du Mali. Ils considéraient, quant à Barkhane, que la mission serait accomplie lorsqu’ils seraient relayés mais face aux djihadistes, dont le centre de gravité est Bamako, l’Etat malien est inefficace. Un sursaut serait la meilleure solution avec les forces locales sous commandement français (l’autorisation des pays étant bien sûr à obtenir), la Force conjointe financée et surtout un changement au sommet des Etats.
SOW, Djiby. Force conjointe du G5 Sahel : perspective stratégique sur l’appropriation sécuritaire par les Etats sahéliens, Diploweb, 20 mai 2018
https://www.diploweb.com/Force-conjointe-du-G5-Sahel-perspective-strategique-sur-l-appropriation-securitaire-par-les-Etats.html [consulté le 6/01/2020]
Juriste et politiste, Djiby Sow est chercheur indépendant, spécialiste des questions de sécurité de l’Afrique de l’Ouest. Il souligne que la France émet le souhait de quitter le Sahel pour laisser les Sahéliens s’approprier leur sécurité, mais cette perspective ne va pas de soi. La Force conjointe, soumise à de fortes contraintes stratégiques dont la mésentente de ses Etats membres, l’impossibilité de se déployer hors des fuseaux transfrontaliers sauf au Mali et le manque de moyens, ne peut pas travailler sans la France qui est en fait le nœud d’un G6. L’opération Barkhane, véritable bras armé de la MINUSMA, est efficace contre le terrorisme même si elle ne peut l’éradiquer de façon structurelle. Les Etats-Unis et l’Algérie veulent exclure la France sous prétexte d’appropriation des Africains mais c’est un faux débat : l’appropriation ne peut avoir lieu qu’avec la France. Celle-ci a aussi des intérêts en Afrique (face à la Chine) et a besoin de son implantation dans ce continent pour exister au plan international.
(Hormis les sources disponibles librement sur internet en texte intégral, les articles et ouvrages cités sont consultables au CDEM, sous forme imprimée ou électronique via les bases Europresse, Cairn-revues ou L’Harmathèque)
La France et le G5 Sahel
Visualiser et télécharger le fichier Biblioveille la France et le G5 SahelPDF - 344.43 Ko
A la une
Un nouveau département pour l’Ecole de Guerre : l’Anglophone Track
Depuis la rentrée 2024, l’Ecole de Guerre comprend un nouveau département baptisé Division Internationale Anglophon...
05 mars 2025

Le CJEX, un défi multinational pour les Écoles de guerre
Début mai, les Écoles de guerre d’Allemagne, d’Espagne, d’Italie, du Royaume-Uni et de France ont conduit conjointe...
30 mai 2024

Allocution de la Directrice générale des relations internationales et de la stratégie devant l'École de guerre
La 31e promotion de l'École de guerre a eu l'honneur d'assister à une allocation de la Directric...
23 mai 2024